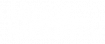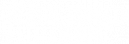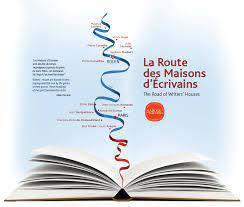Les Travailleurs de la mer
Inv.2004.2.91
Ainsi finit le capitaine Harvey.
François Flameng (Paris, 1856 – Paris, 1923)
Pleine page à l’encre et au fusain destinée à illustrer l’édition Hetzel-Quantin, dite définitive des Œuvres complètes, 1880-1889
Paris, 1887
Inv.2004.2.91
Œuvre acquise et restaurée avec le concours de l’État et de la Région Normandie (FRAM / FRAR)
IX
En l’été de 1867, Louis Bonaparte avait atteint le maximum de gloire possible à un crime. Il était sur le sommet de sa montagne, car on arrive en haut de la honte ; rien ne lui faisait plus obstacle ; il était infâme et suprême ; pas de victoire plus complète, car il semblait avoir vaincu les consciences. Majestés et altesses, tout était à ses pieds ou dans ses bras ; Windsor, le Kremlin, Schœnbrunn et Potsdam se donnaient rendez-vous aux Tuileries ; on avait tout, la gloire politique, M. Rouher ; la gloire militaire, M. Bazaine ; et la gloire littéraire, M. Nisard ; on était accepté par de grands caractères, tels que MM. Vieillard et Mérimée ; le Deux-Décembre avait pour lui la durée, les quinze années de Tacite, grande mortalis œvi spatium ; l’empire était en plein triomphe et en plein midi, s’étalant. On se moquait d’Homère sur les théâtres et de Shakespeare à l’académie. Les professeurs d’histoire affirmaient que Léonidas et Guillaume Tell n’avaient jamais existé ; tout était en harmonie ; rien ne détonnait, et il y avait accord entre la platitude des idées et la soumission des hommes ; la bassesse des doctrines était égale à la fierté des personnages ; l’avilissement faisait loi ; une sorte d’Anglo-France existait, mi-partie de Bonaparte et de Victoria, composée de liberté selon Palmerston et d’empire selon Troplong ; plus qu’une alliance, presque un baiser. Le grand juge d’Angleterre rendait des arrêts de complaisance ; le gouvernement britannique se déclarait le serviteur du gouvernement impérial, et, comme on vient de le voir, lui prouvait sa subordination par des expulsions, des procès, des menaces d’alien-bill, et de petites persécutions, format anglais. Cette Anglo-France proscrivait la France et humiliait l’Angleterre, mais elle régnait ; la France esclave, l’Angleterre domestique, telle était la situation. Quant à l’avenir, il était masqué. Mais le présent était de l’opprobre à visage découvert, et, de l’aveu de tous, c’était magnifique. À Paris, l’exposition universelle resplendissait et éblouissait l’Europe ; il y avait là des merveilles ; entre autres, sur un piédestal, le canon Krupp, et l’empereur des français félicitait le roi de Prusse.
C’était le grand moment prospère.
Jamais les proscrits n’avaient été plus mal vus. Dans certains journaux anglais, on les appelait « les rebelles ».
Dans ce même été, un jour du mois de juillet, un passager faisait la traversée de Guernesey à Southampton. Ce passager était un de ces « rebelles » dont on vient de parler. Il était représentant du peuple en 1851 et avait été exilé le 2 décembre. Ce passager, dont le nom est inutile à dire ici, car il n’a été que l’occasion du fait que nous allons raconter, s’était embarqué le matin même, à Saint-Pierre-Port, sur le bateau-poste Normandy. La traversée de Guernesey à Southampton est de sept ou huit heures.
C’était l’époque où le khédive, après avoir salué Napoléon, venait saluer Victoria, et, ce jour-là même, la reine d’Angleterre offrait au vice-roi d’Égypte le spectacle de la flotte anglaise dans la rade de Sheerness, voisine de Southampton.
Le passager dont nous venons de parler était un homme à cheveux blancs, silencieux, attentif à la mer. Il se tenait debout près du timonier.
Le Normandy avait quitté Guernesey à dix heures du matin ; il était environ trois heures de l’après-midi ; on approchait des Needles, qui marquent l’extrémité sud de l’île de Wight ; on apercevait cette haute architecture sauvage de la mer et ces colossales pointes de craie qui sortent de l’océan comme les clochers d’une prodigieuse cathédrale engloutie ; on allait entrer dans la rivière de Southampton ; le timonier commençait à manœuvrer à bâbord.
Le passager regardait l’approche des Aiguilles, quand tout à coup il s’entendit appeler par son nom ; il se retourna ; il avait devant lui le capitaine du navire.
Ce capitaine était à peu près du même âge que lui ; il se nommait Harvey ; il avait de robustes épaules, d’épais favoris blancs, la face hâlée et fière, l’œil gai.
— Est-il vrai, monsieur, dit-il, que vous désiriez voir la flotte anglaise ?
Le passager n’avait pas exprimé ce vœu, mais il avait entendu des femmes témoigner vivement ce désir autour de lui.
Il se borna à répondre :
— Mais, capitaine, ce n’est pas votre itinéraire.
Le capitaine reprit :
— Ce sera mon itinéraire si vous le voulez.
Le passager eut un mouvement de surprise.
— Changer votre route ?
— Oui.
— Pour m’être agréable ?
— Oui.
— Un vaisseau français ne ferait pas cela pour moi !
— Ce qu’un vaisseau français ne ferait pas pour vous, dit le capitaine, un vaisseau anglais le fera.
Et il reprit :
— Seulement, pour ma responsabilité devant mes chefs, écrivez-moi sur mon livre votre volonté.
Et il présenta son livre de bord au passager, qui écrivit sous sa dictée : « Je désire voir la flotte anglaise », et signa.
Un moment après, le steamer obliquait à tribord, laissait à gauche les Aiguilles et la rivière de Southampton et entrait dans la rade de Sheerness.
Le spectacle était beau en effet. Toutes les batteries mêlaient leurs fumées et leurs tonnerres ; les silhouettes des massifs navires cuirassés s’échelonnaient les unes derrière les autres dans une brume rougeâtre, vaste pêle-mêle de mâtures apparues et disparues ; le Normandy passait au milieu de ces hautes ombres, salué par les hurrahs ; cette course à travers la flotte anglaise dura plus de deux heures.
Vers sept heures, quand le Normandy arriva à Southampton, il était pavoisé.
Un des amis du capitaine Harvey, M. Rascol, directeur du Courrier de l’Europe, l’attendait sur le port ; il s’étonna du navire pavoisé.
— Pour qui donc avez-vous pavoisé, capitaine ? Pour le khédive ?
Le capitaine répondit :
— Pour le proscrit.
Pour le proscrit. Traduisez : Pour la France.
Nous n’aurions pas raconté ce fait, s’il n’empruntait une grandeur singulière à la fin du capitaine Harvey.
Cette fin, la voici.
Trois ans après cette revue de Sheerness, très peu de temps après avoir remis à son passager de juillet 1867 une adresse des marins de la Manche, dans la nuit du 17 mars 1870, le capitaine Harvey faisait son trajet habituel de Southampton à Guernesey. Une brume couvrait la mer. Le capitaine Harvey était debout sur la passerelle du steamer, et manœuvrait avec précaution, à cause de la nuit et du brouillard. Les passagers dormaient.
Le Normandy était un très grand navire, le plus beau peut-être des bateaux-poste de la Manche, six cents tonneaux, deux cent vingt pieds anglais de long, vingt-cinq de large ; il était « jeune », comme disent les marins, il n’avait pas sept ans. Il avait été construit en 1863.
Le brouillard s’épaississait, on était sorti de la rivière de Southampton, on était en pleine mer, à environ quinze milles au delà des Aiguilles. Le packet avançait lentement. Il était quatre heures du matin.
L’obscurité était absolue, une sorte de plafond bas enveloppait le steamer, on distinguait à peine la pointe des mâts.
Rien de terrible comme ces navires aveugles qui vont dans la nuit.
Tout à coup dans la brume une noirceur surgit ; fantôme et montagne, un promontoire d’ombre courant dans l’écume et trouant les ténèbres. C’était la Mary, grand steamer à hélice, venant d’Odessa, allant à Grimsby, avec un chargement de cinq cents tonnes de blé ; vitesse énorme, poids immense. La Mary courait droit sur le Normandy.
Nul moyen d’éviter l’abordage, tant ces spectres de navires dans le brouillard se dressent vite. Ce sont des rencontres sans approche. Avant qu’on ait achevé de les voir, on est mort.
La Mary, lancée à toute vapeur, prit le Normandy par le travers, et l’éventra.
Du choc, elle-même, avariée, s’arrêta.
Il y avait sur le Normandy vingt-huit hommes d’équipage, une femme de service, la stuartess, et trente et un passagers, dont douze femmes.
La secousse fut effroyable. En un instant, tous furent sur le pont, hommes, femmes, enfants, demi-nus, courant, criant, pleurant. L’eau entrait furieuse. La fournaise de la machine, atteinte par le flot, râlait.
Le navire n’avait pas de cloisons étanches ; les ceintures de sauvetage manquaient.
Le capitaine Harvey, droit sur la passerelle de commandement, cria :
— Silence tous, et attention ! Les canots à la mer. Les femmes d’abord, les passagers ensuite. L’équipage après. Il y a soixante personnes à sauver.
On était soixante et un. Mais il s’oubliait.
On détacha les embarcations : Tous s’y précipitaient. Cette hâte pouvait faire chavirer les canots. Ockleford, le lieutenant, et les trois contre-maîtres, Goodwin, Bennett et West, continrent cette foule éperdue d’horreur. Dormir, et tout à coup, et tout de suite, mourir, c’est affreux.
Cependant, au-dessus des cris et des bruits, on entendait la voix grave du capitaine, et ce bref dialogue s’échangeait dans les ténèbres :
— Mécanicien Locks ?
— Capitaine ?
— Comment est le fourneau ?
— Noyé.
— Le feu ?
— Éteint.
— La machine ?
— Morte.
Le capitaine cria :
— Lieutenant Ockleford ?
Le lieutenant répondit :
— Présent.
Le capitaine reprit :
— Combien avons-nous de minutes ?
— Vingt.
— Cela suffit, dit le capitaine. Que chacun s’embarque à son tour. Lieutenant Ockleford, avez-vous vos pistolets ?
— Oui, capitaine.
— Brûlez la cervelle à tout homme qui voudrait passer avant une femme.
Tous se turent. Personne ne résista ; cette foule sentant au-dessus d’elle cette grande âme.
La Mary, de son côté, avait mis ses embarcations à la mer, et venait au secours de ce naufrage qu’elle avait fait.
Le sauvetage s’opéra avec ordre et presque sans lutte. Il y avait, comme toujours, de tristes égoïsmes ; il y eut aussi de pathétiques dévouements[1].
Harvey, impassible à son poste de capitaine, commandait, dominait, dirigeait, s’occupait de tout et de tous, gouvernait avec calme cette angoisse, et semblait donner des ordres à la catastrophe. On eût dit que le naufrage lui obéissait.
À un certain moment il cria :
— Sauvez Clément.
Clément, c’était le mousse. Un enfant.
Le navire décroissait lentement dans l’eau profonde.
On hâtait le plus possible le va-et-vient des embarcations entre le Normandy et la Mary.
— Faites vite, criait le capitaine.
À la vingtième minute le steamer sombra.
L’avant plongea d’abord, puis l’arrière.
Le capitaine Harvey, debout sur la passerelle, ne fit pas un geste, ne dit pas un mot, et entra immobile dans l’abîme. On vit, à travers la brume sinistre, cette statue noire s’enfoncer dans la mer.
Ainsi finit le capitaine Harvey.
Qu’il reçoive ici l’adieu du proscrit.
Pas un marin de la Manche ne l’égalait. Après s’être imposé toute sa vie le devoir d’être un homme, il usa en mourant du droit d’être un héros.
Actes et Paroles. Ce que c’est que l’exil, IX